À partir de quel moment devient-on trop riche ? La plupart des gens répondront : quand on gagne bien plus que moi. Si vous touchez un salaire britannique moyen, vous appartenez sans doute aux 10 % des personnes les plus riches du monde, et si vous pesez 530 000 livres ou plus [environ 609 000 euros] — ce qui est le cas de trois millions d’entre nous — vous appartenez au club fermé des 1 % qui détiennent presque la moitié des richesses de la planète.
Quand nous possédons bien plus que les autres, nous sommes convaincus de le mériter ; quand nous sommes bien moins riches qu’autrui, nous y voyons une injustice criante. Les millionnaires ont toujours suscité l’envie, mais les milliardaires — sans parler de multimultimilliardaires tels Jeff Bezos ou Elon Musk — provoquent de plus en plus l’indignation.
Avec Nietzsche, nous pourrions n’y voir que de la rancœur. La richesse est synonyme de pouvoir, et ceux qui en sont privés ont un sentiment aigu d’injustice. Nietzsche affirmait que la vénération des chrétiens pour les pauvres nous a permis de transformer un désavantage matériel en avantage spirituel. Si l’aisance matérielle est associée au mal, les pauvres peuvent se sentir vertueux, et non plus inférieurs.
Richesse et mérite
Pour justifier l’inégalité des richesses, les libertariens soulignent que nous avons le droit au fruit de notre travail — ou de celui de nos ancêtres —, et que le refuser constitue une atteinte à la liberté. Nietzsche n’est pas si éloigné. Dans une telle analyse, les taux d’imposition des États modernes sont intolérablement élevés.
Le libertaire n’a pas besoin de nier le fait que la répartition des richesses n’a pas grand-chose à voir avec le mérite ou le mérite, ce sur quoi les philosophes ont compté pendant des siècles. Au 18ème siècle, même le politiquement conservateur David Hume pouvait voir que la richesse dépendait beaucoup du hasard. Mais il pensait toujours que la « stabilité de la possession » était si importante pour un commerce fructueux et une société pacifique que « l’aptitude ou l’adéquation ne devrait jamais entrer en considération dans la distribution des biens de l’humanité ». En bref, l’argument est qu’une société libre et prospère nécessite des droits de propriété solides, y compris le droit de conserver sa richesse. Cela, selon certains, peut entraîner une distribution injuste, mais toute tentative d’imposer l’équité divine se traduira par un enfer humain, comme l’ont montré diverses expériences communistes.
Cet argument serait plus convaincant si la richesse coulait naturellement de manière aussi inégale qu’elle le fait actuellement. La vérité est plutôt que le capitalisme moderne canalise activement de l’argent vers une petite élite. Les entreprises comptent sur les États pour éduquer leur main-d’œuvre, fournir des soins de santé et compléter les salaires avec des avantages sociaux. L’entreprise a besoin d’une bonne infrastructure, ainsi que de systèmes juridiques fonctionnels pour protéger les droits des entreprises. Bref, la possibilité même d’être milliardaire dépend d’un ordre politique et financier complaisant.
Les arguments en faveur d’une restriction de l’extrême richesse semblent donc solides. En effet, on pourrait soutenir que la charge de la preuve incombe à ceux qui défendent l’existence des milliardaires pour montrer pourquoi ils devraient être autorisés à siphonner autant de dollars. Mais, honnêtement ou non, la charge de la preuve a été placée sur ceux qui soutiennent qu’un plafond de richesse devrait être érigé. Une personne qui a relevé ce défi est la philosophe politique belgo-néerlandaise Ingrid Robeyns. Elle a plaidé en faveur du «limitarianisme», qui prétend que «personne ne devrait avoir plus qu’un seuil supérieur de biens de valeur».Alors que la plupart des philosophies politiques modernes ont été « axées sur la théorie » – établissant des principes généraux de justice puis les appliquant – Robeyns adopte une approche « axée sur les problèmes », affirmant que le limitarianisme répond à deux exigences pressantes. Premièrement, le monde doit faire face à de nombreux « besoins urgents non satisfaits », tels que la pauvreté et le changement climatique. Elle soutient que « s’il y a des interventions… qui peuvent atténuer des besoins urgents non satisfaits et qui nécessitent des ressources financières, l’argent excédentaire devrait être utilisé pour répondre à ces besoins ». Et sur toute définition raisonnable de «l’argent excédentaire», la richesse excédentaire des milliardaires correspond à la description.
Deuxièmement, la possession de cette richesse excédentaire par les super-riches constitue une menace pour l’égalité politique qu’exige la démocratie. Des différentiels de richesse massifs sont incompatibles avec une société démocratique, puisque la richesse dévie le pouvoir vers ceux qui la possèdent et diminue l’agence politique de ceux qui n’en ont pas.
Le limitarianisme n’est peut-être pas encore devenu un mot à la mode politique, mais il semble être en phase avec l’air du temps culturel. Il peut y avoir de bonnes raisons pragmatiques pour permettre aux gens de devenir riches, mais celles-ci ne justifient pas de permettre à ceux qui sont déjà riches de devenir encore plus riches. L’utilisation récente d’impôts exceptionnels sur les sociétés énergétiques a peut-être ouvert la voie à l’acceptation du principe plus large selon lequel il n’y a pas de droit fondamental à des revenus illimités.
Les démocraties partent à juste titre d’une présomption de liberté et ne la restreignent que lorsqu’il existe des justifications solides et convaincantes pour le faire. Mais une interdiction de milliardaire ne devrait pas être considérée comme une mesure extrême par quiconque reconnaît qu’il n’est possible de devenir extrêmement riche qu’en extrayant plus de richesses de la société que vous ne pourriez jamais créer par vous-même.
Source : prospectmagazine.co.uk

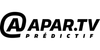


![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)





