Il n’aura jamais de Goncourt ou de Nobel, mais il marquera sa génération pour l’histoire. Créateur de la plus grande icône de pop culture de la fameuse, et mal intitulée, génération Y : Tyler Durden. Chantre de la réalité, qui crie le besoin de douleur, d’auto-destruction, pour se sentir en vie. Un concept qui se retrouve actuellement dans tous les grands phénomènes de notre société : du départ au Djihad au skins party.
Chuck Palahniuk a suivi le conseil de simplicité d’Hemingway qui appelait à « écrire comme Cézanne peint », comme beaucoup d’écrivain américain. Précision chirurgicale du style, là où les faits se suffisent à eux-mêmes, où la puissance de la réalité dépassé et enfonce la douce folie de la fiction.
Soyons francs, cela fait trois ans que nous envoyons régulièrement des mails à Chuck Palahniuk pour une interview. Pourquoi ? Comment ? Il y a un mois, il nous répondait favorablement. Excitation d’enfant devant les cadeaux de Noël. Il nous aura fallu choisir nos questions alors que nous parlions à un pan d’histoire, tel un journaliste politique interrogeant Henry Kissinger.
Chuck mother fucking Palahniuk.
Dans tous vos romans, vous levez le voile. Vous révélez la réalité. À quel moment de votre vie avez-vous compris que la vie social était une pièce ?
Quand j’avais six ans, mes parents m’ont appris que le Père Noël n’existe pas. C’est là que j’ai compris que la « réalité » est basée sur des agréments sociaux acceptés de tous. Ainsi, en tant qu’écrivain, si je peux créer un mensonge suffisamment convaincant, je peux aussi imposer ma réalité.
Quand vous écrivez, quelle partie de vous-même s’exprime ? Est-ce la partie rationnelle ou quelque chose de plus instinctif ? Est-ce une réflexion ou une catharsis ?
Cela varie. La plupart du temps, dans mes fictions plus courtes, je travaille comme un journaliste, me documentant sur une histoire ou en utilisant des confessions que les gens m’ont faites. Je dis « confesser » parce que typiquement, il s’agit de secret assez sombres et les gens me font confiance pour ne pas les juger.
Dans mes travaux plus longs, j’extrapole et explore certains problèmes de ma propre vie, souvent des obstacles que je ne peux pas surmonter ou tolérer. Une fois que j’ai épuisé mes réactions émotives face au problème, il s’évanouie.
Dans vos romans, il y a toujours une récurrence, un leitmotiv, une forme syntaxique qui revient encore et encore. Cherchez-vous à ce que vos histoires paraissent plus obsessionnelles, presque psychotiques, ou est-ce simplement pour donner un rythme ?
Ce dispositif (je l’appelle le « chœur »), c’est ma technique pour garder les événements passés tout au long de l’histoire. En tant qu’humain, nous expérimentons chaque instant à travers l’écran de notre passé. De même, ces répétitions, ces échos rappellent constamment au lecteur les événements passés. Les moments à venir accumulent ainsi un poids sans sacrifier d’élan narratif.
Vous avez été le premier à mettre en avant des phénomènes générationnels comme l’utilisation de l’auto-violence pour se sentir vivant. Quelle est la prochaine étape selon vous ?
Ce que je décris est une violence consensuelle. Il n’y a pas de méchant ou de victime. Peut-être que le paroxysme de cette logique est le suicide.
Vous semblez prendre du plaisir à détruire le beau. C’est quelque chose que nous avons tous en nous, c’est hautement cathartique. Prenez-vous plaisir à l’écrire ?
Mon plaisir vient en détruisant une beauté passée; une forme de pouvoir, pour faire de la place pour la nouveauté, une forme de pouvoir encore plus grande. Quand nous sommes jeunes, nous cherchons tous une vocation, une carrière, avant que le pouvoir de notre beauté ne fane. Mes personnages en sont très conscients, tellement conscients qu’ils sont hyper-actifs dans la destruction de leur propre beauté pour laisser de la place à leur prochain soi, plus puissant.
Vous faîtes souvent référence à l’intelligence des lecteurs. Plus intelligents que le pense la plupart des écrivains. Vous vous souvenez du premier livre que vous ayez lu et qui vous a fait dire : « je me sens plus intelligent » ?
Quand j’étais gamin, j’adorais les polars, en particulier ceux d’Ellery Queen, où les indices étaient disséminés subtilement et où l’on a une chance de résoudre le crime avant que l’auteur révèle le coupable. Depuis, j’adore tous les livres ou films qui arrivent à me berner. Très peu y arrive.
À chaque fois que je lis l’un de vos livres, c’est le même mystère en moi. Je suis incapable de dire si le livre parle à la partie rationnelle de mon cerveau ou à mon cerveau reptilien ?
Mon objectif est toujours d’impliquer votre esprit, votre cœur et vos tripes. La plupart des livres n’en enrôle que deux sur trois, mais très peu de livre parle au trois niveaux.
Je pense qu’aucune écriture est aussi libre que la vôtre. Les autres écrivains semblent toujours se restreindre à un certain point. Aller jusqu’au bout de vos idées, est-ce important pour vous ? Et est-ce quelque chose que vous enseignez à vos étudiants ?
La plus grande qualité, c’est de charmer le lecteur pour que le voyage soit accompli sans restriction. Parfois, il est plus facile de dépeindre un challenge, des histoires extrêmes, mais un écrivain doit aussi pouvoir séduire son lectorat pour qu’il n’abandonne pas la peur ou le dégoût. Les étudiants savent parfois raconter des histoires extrêmes, mais il faut souvent leur apprendre l’art de maintenir subtilement la tension du lecteur.
Tous vos personnages ont un quelque chose de Meurseault de L’Étranger. Est-ce juste dans mon esprit ?
Depuis que Fight Club a été publié pour la première fois, les gens ont fait se rapprochement. La vérité est que je n’ai jamais lu Camus.
Dans la tradition absurde, des gens ordinaires sont dans des situations extraordinaires, créées par les circonstances, et restent passifs. Dans vos romans, il en va de même, sauf que vos personnages sont actifs.
Mes personnages découvrent toujours qu’ils ont créé eux-mêmes les circonstances de leur propre destruction. Comme la plupart d’entre nous. Presque nous tous en fait. Pourtant, peu de personne sont prêts à accepter ce fait et reconnaître que les possibilités sont beaucoup plus grandes une fois qu’on a solutionné ce jeune, petit et faible soi. Ils préfèrent passer leur vie en deuil de ce soi perdu.
Si je vous dis que vous êtes un Camus extrémiste, ça vous va ?
Vous pouvez bien dire ce que vous voulez tant que vous me flattez en disant que je suis aussi séduisant que Camus. C’était une bombe ce type.
Tyler Durden est l’icône d’une génération. Avez-vous conscience de l’impact de votre création ?
Oui, je ne suis que trop conscient que mes personnages vivent par-delà moi. C’est un sentiment très étrange, qui ne va pas sans une forme de jalousie et de regret.
Vous portez des pansements sur votre site, votre adresse mail s’y réfère directement… Êtes-vous aussi marqué par Fight Club que nous tous, ou est-ce simplement une facilité marketing ?
À mon avis, ce n’est qu’une stratégie.
À ce propos, comment avez-vous créé ce nom : Tyler Durden ?
Cela fait partie de mes plus grands regrets : j’ai utilisé le nom d’un de mes collègues qui a dû quitter son poste à cause d’accusations de harcèlement sexuel. Même s’il était coupable, il ne méritait pas que son nom soit déshonoré pour toujours.
Votre identité artistique est particulièrement marquée. Je suis curieux, quel artiste (dans quelque domaine que ce soit) admirez-vous ?
J’admire tous les acteurs avec lesquels j’ai eu la chance de rencontrer : Edward Norton, Brad Pitt, Sam Rockwell, et, j’espère bientôt, James Franco.

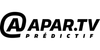
![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)


![[INTERVIEW] Luiza Rozova, fille de Poutine : "Pour moi, les plans de vengeance relèvent du suicide karmique"](/content/images/size/w100/2025/06/IMG_8972--2-.webp)





