L’ancien patron du renseignement intérieur français, Bernard Squarcini, vient d’être condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme, pour avoir monnayé son influence au profit de puissants intérêts privés, notamment ceux du PDG de LVMH, Bernard Arnault. Une décision judiciaire qui révèle un entrelacs troublant entre le pouvoir, la surveillance d’État et l’argent.
Alors que l’affaire met en lumière des pratiques dignes d’un roman d’espionnage, elle pose une question vertigineuse : et si le renseignement n’était plus une question de sécurité nationale, mais une ressource privatisée, achetable au plus offrant ?
L’intelligence économique : un euphémisme pour une mafia institutionnalisée
Dans les hautes sphères du pouvoir, la frontière entre intérêt général et intérêts privés devient poreuse. Bernard Squarcini, ex-chef de la DCRI (devenue DGSI), est accusé d’avoir détourné l’appareil d’État au bénéfice de son réseau, obtenant des informations confidentielles et des passe-droits en échange de services rendus à une élite économique.
LVMH, empire du luxe dirigé par Bernard Arnault, est souvent cité comme l’un des bénéficiaires de ces pratiques. L’accusation est simple : utiliser l’appareil du renseignement intérieur pour protéger les affaires d’un géant privé. On quitte alors le cadre du renseignement d’État pour entrer dans celui d’un service de renseignement privé, déguisé sous les oripeaux de l’appareil républicain.
La sanction – deux ans de prison ferme et une amende de 200 000 euros – semble presque anecdotique au regard des infractions reprochées : trafic d’influence, compromission du secret de la défense nationale, faux en écriture publique… Une liste qui, dans d’autres circonstances, aurait fait vaciller bien des responsables politiques.
Mais au fond, Squarcini est-il un cas isolé, ou la partie émergée d’un iceberg beaucoup plus profond ?
L’État profond : mythe complotiste ou réalité bien tangible ?
Les grands empires économiques ont-ils leur propre bras armé au sein des institutions publiques ? L’affaire Squarcini illustre une réalité bien connue des initiés : la collusion entre l’État, les grandes entreprises et les organes de renseignement.
On nous répète que la démocratie repose sur la séparation des pouvoirs, mais cette affaire démontre que certaines sphères de l’État opèrent dans une zone grise où les intérêts nationaux et privés se confondent. Les réseaux d’anciens hauts fonctionnaires, d’ex-magistrats et de préfets ne disparaissent pas lorsqu’ils quittent leurs fonctions officielles. Ils continuent d’agir dans l’ombre, sous couvert de consulting ou d’intelligence économique, dans un entre-deux juridico-politique où les règles sont élastiques et les alliances changeantes.
Bernard Squarcini n’est ni un héros, ni un simple corrompu. Il incarne une figure intermédiaire entre le pouvoir et l’argent, un passeur, un négociant en influence, évoluant dans ces zones où l’impunité est la norme.
Et maintenant ? Un simulacre de justice ?
Son avocate a déjà annoncé qu’il ferait appel. L’histoire judiciaire française est pavée de condamnations en première instance suivies d’arrangements en appel ou de peines symboliques qui, in fine, permettent aux puissants de retomber sur leurs pieds.
Si Squarcini avait agi pour le compte d’un petit entrepreneur ou d’un activiste, l’issue aurait été bien différente. Mais l’écosystème politico-économique français ne punit jamais trop durement ceux qui savent trop de choses sur les coulisses du pouvoir.
L’enjeu dépasse l’affaire Squarcini : qui surveille les surveillants ? Qui garantit que les services de renseignement ne sont pas instrumentalisés au profit des multinationales ? Ou plus cyniquement : peut-on encore faire semblant d’être surpris quand un haut fonctionnaire met son savoir-faire au service du capital plutôt que de l’État ?
La réponse se trouve peut-être dans le verdict final. Si l’appel lui est favorable, nous aurons une nouvelle preuve que la justice est, elle aussi, une monnaie d’échange dans ce grand marché du pouvoir.

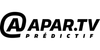
![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)






