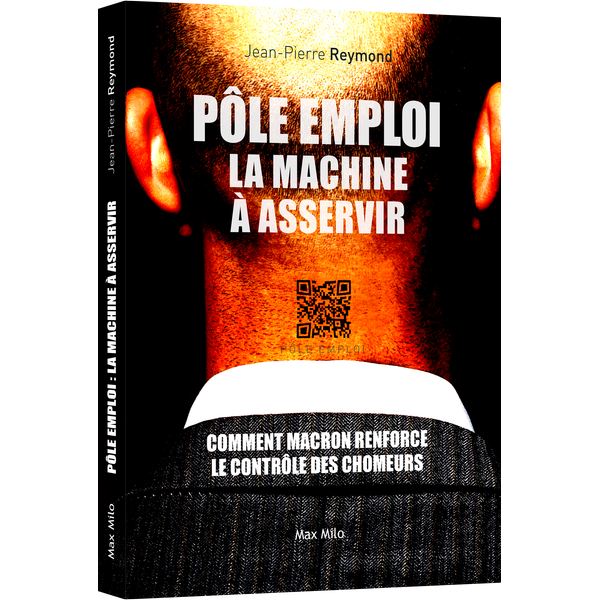Les Jeunes en Marche face à un défi inédit : l’émergence de « 99 % Youth », le futur bras politique de Juan Branco
Gabriel Attal face à Juan Branco dans un débat explosif ? Les Jeunes en Marche, qui ne représentent que 1 % des jeunes, vont se faire écraser par 99 % Youth, le nouveau mouvement qui promet de tout balayer. La jeunesse française est prête pour la révolution et la politique punk !

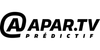

![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)