Candace Owens vs Macron : Un enregistrement qui pourrait changer la face du monde
Alors que la guerre en Ukraine fait rage, Candace Owens détient un enregistrement où Trump supplie de taire une enquête sur Brigitte Macron, sous peine de voir la paix compromise. Des centaines de milliers de vies sont en jeu...

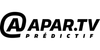


![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)







