Cover-Up : Le vestige incandescent d’un journalisme sans compromis
Dans une époque où l’information est noyée dans le bruit et la confusion orchestrée, Laura Poitras signe avec Cover-Up (co-réalisé avec Mark Obenhaus) un portrait brûlant de Seymour Hersh, ce géant du journalisme qui a révélé My Lai, Abu Ghraib et tant d’autres scandales enfouis par le pouvoir.

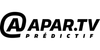

![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)

