Si l’on se fie aux projections actuelles, d’ici la fin de cette décennie, l’IA pourrait bien révolutionner la manière dont nous abordons les soins psychologiques, oscillant entre promesses d’accessibilité et défis éthiques colossaux.
Des études récentes, comme celles publiées sur ScienceDirect, prédisent que l’IA deviendra un allié incontournable des psychologues. Déjà, des applications comme Woebot ou Wysa jouent un rôle de soutien émotionnel de premier niveau. À l’avenir, ces outils pourraient aller plus loin : réaliser des évaluations initiales, assurer un suivi continu ou encore repérer précocement les signes de troubles mentaux. Les psychologues, libérés des tâches répétitives, pourraient alors se consacrer pleinement à ce que les machines ne savent pas encore faire : offrir une écoute profonde, empreinte d’humanité, pour les cas les plus complexes.
Un accès élargi, mais à quel prix ?
D’ici 2030, ce mariage entre technologie et expertise humaine pourrait transformer l’accès aux soins, notamment dans les zones rurales ou mal desservies. Imaginez un monde où une application détecte les premiers signaux de détresse chez un adolescent isolé, l’orientant vers un professionnel avant que la situation ne s’aggrave. Ce rêve d’une santé mentale plus inclusive est à portée de main. Mais il y a un revers : la confidentialité des données et la sécurité des utilisateurs restent des préoccupations majeures. En 2024, un drame aux États-Unis – un suicide d’adolescent lié à une IA, rapporté par Franceinfo – a jeté une lumière crue sur ces risques. Sans régulations strictes, l’IA pourrait devenir une arme à double tranchant.
Envie de lire la suite ?
Les articles d’APAR.TV en intégralité à partir de 9,99 €/mois
abonnés seulement.
Je m'abonne

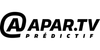

![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)






