L’affaire Griveaux devrait s’appeler « Second commentaire sur la société du spectacle ». Debord nous prévient d’emblée à sa manière expéditive : « j_e ne suis pas quelqu’un qui se corrige._ » Il ne se corrige pas, mais il se complète. Ainsi aurait-il décelé, à côté du spectaculaire concentré, celui des grands totalitarismes, et du spectaculaire diffus, celui de « l’américanisation du monde », un spectaculaire nouveau, qu’il nomme spectaculaire intégré : c’est « l’unification fructueuse » des deux précédents spectaculaires : « à considérer le côté concentré, le centre directeur en est maintenant devenu occulte : on n’y place jamais plus un chef connu, ni une idéologie claire.” On croirait lire les statuts de La République en Marche.
“À considérer le côté diffus, l’influence spectaculaire n’avait jamais marqué à ce point la presque totalité des conduites et des objets qui sont produits socialement. Car le sens final du spectaculaire intégré, c’est qu’il s’est intégré dans la réalité même à mesure qu’il en parlait ; et qu’il la reconstruisait comme il en parlait.”
On est cette fois perdu dans les commentaires d’un groupe Facebook.
Tout cela reste cependant un peu général. Mais la suite est terriblement plus spécifique. Debord parle ainsi de la fin parodique, carnavalesque, de la division du travail : “un financier va chanter, un avocat va se faire indicateur de police, un boulanger philosophe ».
Debord aurait adoré Thierry Marx.
Debord aurait adoré Benjamin Griveaux : « chacun peut surgir dans le spectacle afin de s’adonner publiquement, ou parfois pour s’être livré secrètement, à une activité complètement autre que la spécialité par laquelle il s’était d’abord fait connaître. »
Debord aurait également adoré Juan Branco : « On peut désormais publier un roman pour préparer un assassinat. » ou plus modestement, comme l’auteur de Crépuscule, rêver de transformer un best-seller en coup d’État, et un transpalette en cuirassée Potemkine.
“Mais, conclut aussitôt Debord, l’ambition la plus haute du spectaculaire intégré, c’est encore que les agents secrets deviennent des révolutionnaires, et que les révolutionnaires deviennent des agents secrets” : et c’est Piotr Pavlenski qu’on croit deviner un instant.
Debord prophétise également le fonctionnement des réseaux sociaux : “le domaine de l’histoire était le mémorable, la totalité des événements dont les conséquences se manifesteraient longtemps (…) Une acquisition pour toujours, dit Thucydide. Par là l’histoire était la mesure d’une nouveauté véritable ; et qui vend la nouveauté a tout intérêt à faire disparaître le moyen de la mesurer.” Si l’excitation électronique que décrit Debord est initialement une aubaine, pour les ambitieux, celle-ci leur confisque aussitôt un pouvoir qui leur fut aussi facile à prendre qu’impossible à garder : “un État, dans la gestion duquel s’installe durablement un grand déficit de connaissances historiques, ne peut plus être conduit stratégiquement.”
La suite est plus troublante encore, et d’une contemporanéité relativement irréfutable : “La société qui s’annonce démocratique, quand elle est parvenue au stade du spectaculaire intégré, semble être admise partout comme étant la réalisation d’une perfection fragile. (…) C’est une société fragile parce qu’elle a grand mal à maîtriser sa dangereuse expansion technologique. Mais c’est une société parfaite pour être gouvernée. Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats.” Ce terrorisme, Debord l’identifie largement à celui des années de plomb, ce qui nous autorise à exporter son analyse à la stratégie de la tension actuelle, qui s’est cristallisée autour des gilets jaunes — « sorte de vaste insurrection armée qui par hasard n’a jamais vu venir son heure, un putschisme tissé de l’étoffe dans son fait les rêves.”
Mais on retrouve très vite Pavlenski, dans le cas que Debord examine ensuite, celui d’un activiste extradé en France, un certain Gabor Winter dont la justice avait affirmé : “qu’il n’était pas un délinquant politique, mais social. Il refuse les contraintes sociales. Un vrai délinquant politique n’a pas de sentiment de rejet devant la société. Il s’attaque aux structures politiques et non comme Gabor Winter aux structures sociales”.
On voit enfin passer, au loin, le sourire bizarrement kennedien du président Macron, posé sur cette tête qu’on dirait toujours sortie des années 60 : “la société moderne qui, jusqu’en 1968, allait de succès en succès, et s’était persuadée qu’elle était aimée, a dû renoncer depuis lors à ces rêves ; elle préfère être redoutée. Elle sait bien que son air d’innocence ne reviendra plus. »
C’est ce grand désarroi, je crois, qu’on ressent jusqu’au sommet de l’État.
Source : Aurélien Bellanger – France Cul

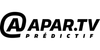


![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)






