Le combat judiciaire n’est pas qu’une bataille de droit, c’est une guerre économique où les moyens financiers conditionnent l’accès à la défense. L’affaire Zoé Sagan en est un exemple frappant : faut-il accepter la condamnation et payer l’amende, ou investir dans une défense coûteuse pour préserver son innocence et ses principes ?
Le prix de la vérité : quand l’avocat coûte plus cher que la peine
Zoé Sagan, poursuivi pour diffamation publique et cyberharcèlement, risque jusqu’à 57 000 € d’amende et 3 ans de prison. Face à cela, l’option naturelle serait de se défendre avec un avocat. Mais à quel prix ?
Un avocat spécialisé facture en moyenne 300 € de l’heure. Avec une préparation estimée à 120 heures, le coût minimal d’une défense efficace est 36 000 €. Pour un procès long et complexe, la facture peut grimper à plus de 100 000 €. En d’autres termes, le coût de la défense dépasse l’amende encourue, et sans garantie de relaxe. Payer pour se battre devient un luxe inaccessible pour beaucoup.
Dans un tel contexte, se défendre devient un calcul froid : qu’est-ce qui coûte le moins cher, la vérité ou la soumission ?
Se défendre quand on est pauvre : la justice à deux vitesses
Si payer un avocat est inabordable, quelles sont les options ? Pour un individu au RSA, la défense devient un parcours du combattant, où chaque euro dépensé est un sacrifice vital.
1️⃣ L’aide juridictionnelle : une défense (presque) gratuite
Pour ceux gagnant moins de 1 078 € par mois, l’État peut couvrir jusqu’à 100 % des frais d’avocat.
Entre 1 078 € et 1 617 €, une prise en charge partielle est possible.
Problème ? Peu d’avocats acceptent ces dossiers, car leur rémunération est bien inférieure à leurs tarifs habituels. Les plus démunis doivent donc se contenter d’une défense au rabais.
2️⃣ Faire appel à des avocats bénévoles ou militants
Certaines associations (SAF, LDH, ADIL) défendent gratuitement des affaires de liberté d’expression.
Problème ? Peu d’avocats prennent des dossiers médiatiques sans rémunération.
3️⃣ Lancer une cagnotte publique
Sur Leetchi, GoFundMe, CotizUp, mobiliser le soutien populaire peut financer une défense.
Exemple : Christophe Dettinger (boxeur des Gilets Jaunes) a levé 145 000 € pour ses frais juridiques.
Problème ? Les plateformes peuvent bloquer la cagnotte si elle est jugée « politiquement sensible ».
4️⃣ Se défendre seul : l’ultime recours
Télécharger les textes de loi et préparer une défense écrite.
Déposer une demande de nullité si des vices de procédure existent.
Problème ? Un non-initié face à un tribunal est un condamné en sursis.
L’injustice financière : pourquoi le pouvoir privilégie la peur à la vérité
Si la justice était véritablement juste, elle garantirait les mêmes moyens de défense à tous. Or, le système est conçu pour favoriser ceux qui ont les moyens de se battre et décourager ceux qui n’ont pas les ressources pour tenir tête au pouvoir. Ce déséquilibre pousse la majorité des accusés à accepter leur condamnation plutôt que de s’endetter à vie pour la contester.
Dans l’affaire Zoé Sagan, la stratégie judiciaire employée illustre une répression financière déguisée : l’État n’a pas besoin d’avoir raison, il suffit qu’il ait plus d’argent pour forcer l’abandon.
Se battre ou se soumettre ?
La question n’est plus seulement juridique, elle est philosophique : jusqu’où est-on prêt à aller pour défendre sa liberté et son honneur ?
Si l’on accepte la condamnation sans lutter, on valide un précédent dangereux : seul celui qui peut payer peut contester le pouvoir. Mais si l’on se bat, on s’expose à un engrenage financier et psychologique qui peut briser une vie.
Alors que reste-t-il ?
Ceux qui ont des moyens choisissent la vérité.
Ceux qui n’en ont pas choisissent la résignation.
Ceux qui n’ont plus rien à perdre choisissent la révolte.
Zoé Sagan est aujourd’hui à la croisée des chemins. Mais derrière son cas, c’est une question plus vaste qui se pose : une justice qui coûte plus cher que la peine est-elle encore une justice, ou simplement un instrument de domination ?

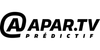

![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)






