Il écrit tout le temps, partout. Sur les livres, sur les magazines, sur son site… en permanence. Écolier, François Bégaudeau devait écrire sur les tables, sur les murs, sur son bras.
Son dernier livre, La Politesse parle de l’écriture, des gens qui parlent de l’écriture, de l’écriture qui parle de… enfin, bref, François Bégaudeau joue avec les mots comme ceux qui les aiment vraiment. Comme ceux qui ne cherchent pas un style arrêté pour exister, mais préfère évoluer sans cesse, parce qu’au final, seule la langue compte vraiment.
Toujours disponible pour répondre à des questions, l’homme en mouvement à soif de rencontres, on le sent. Quand on aime les mots, on aime les gens. Mais il ne faut pas trop aimer les hommes, car à force de les fréquenter, on finirait pas les détester.
J’aimerais commencer par une phrase au début de votre livre : « Mais pour dire quelque chose, il faut renoncer à dire tout. » D’abord, je la trouve magnifique, mais elle en dit long sur la difficulté de faire simple. Ne pas pouvoir tout dire, c’est une frustration en tant qu’écrivain ?
Frustration est excessif. Cela demande juste un peu de discipline, un peu de sécheresse avec soi-même. Parfois on est content d’une idée, d’une notation, d’une scène, or arrive un moment où il apparaît plus ou moins clairement qu’elle n’a pas sa place dans le livre, dans sa structure, dans son esprit. Il faut s’armer de sécheresse pour la virer. Écrire c’est tailler dans le lard. C’est soustraire. Par rapport au vécu, il y a énormément de faits que j’ai soustraits pour écrire La politesse, énormément de commentaires que je pouvais livrer. Je me les suis interdit, pour tendre à une narration « objective » et tenir le cap d’un narrateur le plus muet possible. Ce que j’entends par muet : descriptif et non discursif.
J’ai toujours été assez étonné de la différence d’image que vous renvoyez entre votre expression orale (je parle de la télé) et écrite. Quelque chose de l’ordre la certitude et du doute, peut-être. Je me fous de savoir lequel est le vrai François Bégaudeau, j’imagine que ce sont les deux, mais est-ce que vous sentez effectivement que vous n’exprimez pas la même chose selon le média choisi ?
Tous les modes d’apparition ont leur part de vérité. Simplement, il y en a qui sont plus contraignants et moins avantageux que d’autres. Le biotope d’un plateau de télé, puisque c’est sans doute de ça que vous parlez, par sa brièveté et une certaine nervosité ambiante, produit mécaniquement des énoncés expéditifs, des assertions. Tout le monde s’y trouve tiré à un certain dogmatisme. C’est une des raisons pour lesquelles je m’en passe volontiers, et que j’ai arrêté le Cercle cette année. Je préfère les plages d’expression longue (par exemple celle de la table ronde de Transfuge que nous mettons en ligne tous les mois), où on peut avancer plus calmement, en marquant des nuances, etc. L’écrit étant évidemment le lieu le plus ajusté à celui qui veut rendre justice à une certaine complexité. C’est le principal grief, au fond, que j’aurais contre les formats radio et télé : elles nous tirent à notre part la moins intéressante. La télé toujours, la radio souvent, ne donnent pas de talent aux invités. Je l’avais dit à Pascale Clarke en sortant de son émission où elle ne m’avait posé que des questions à la con : vous ne m’avez pas donné de talent. Visiblement elle a du en garder l’idée que j’étais un connard. J’en suis flatté.
Je pensais que les gens se montraient critiques seulement dans l’anonymat. Sinon, ils préféraient dire du mal dans le dos. Dans votre livre, on voit des gens asséner des choses assez dures en face, l’air de rien. Si ces faits sont vrais, comment l’expliquez-vous ? Quand on est un personnage public, on a le droit d’être rabroué ?
C’est quand même assez rare. En général les gens sont plutôt respectueux, ou timides (excessivement) ou faux-culs. Mais je voulais, dans le livre, faire une part, à ces petites agressions qu’on subit parfois, parce qu’elles sont drôles et cruelles. La drôlerie cruelle est un peu l’espace attitré de ce livre ci. Sachant que les agressions plus intéressantes sont celles qui s’ignorent. Le type qui tient absolument à vous dire qu’il n’a pas envie de lire votre livre, il n’est pas forcément méchant. Il est juste un peu bête. Une sorte de bêtise relationnelle. D’inintelligence de la situation. Ce serait une première définition que je donnerai à la politesse : une intelligence d’une situation interrelationnelle. C’est d’abord en cela qu’elle m’intéresse : comme faculté d’analyse. Comme exercice de la sensibilité.
À force de rencontrer des gens qui ont des idées préconçues sur vous, est-ce que par moment on finit pas par les croire ?
Un type qui ne connaît de moi que trois minutes de télé ou deux heures de film, ou une interview dans Télérama, a forcément sur moi un immense retard dans la compréhension de moi-même. Parce que moi ça fait 44 ans que je me fréquente, que j’étais là à chaque minute, et que j’ai lu tous mes livres – ce qui m’a couté beaucoup de sueurs, croyez-moi. Donc j’ai du mal à accréditer son jugement. Le seul jugement vraiment incontestable, dans ce cas, c’est : vous avez une sale gueule. Parce que, pour le coup, ma gueule je ne la vois jamais (une minute par jour en me brossant les dents). Les autres ont sur ma gueule une expertise bien supérieure à la mienne. Donc là, je m’incline. Sale gueule ? Ok. Il faut être modeste. Une fois Kate Winslet me dit : t’es plus beau que Leonardo. Je dis : écoute Kate, je ne suis pas d’accord avec toi, mais tu es mieux placée que moi pour juger. Elle en a convenu.
Votre écriture est rarement arrêtée dans son style. En particulier dans celui-ci, vous en jouez. On sent une forme d’empirisme ou de jeu. C’est très plaisant je trouve pour le lecteur. Ça nous laisse une marge de manœuvre, de liberté. C’est volontaire de votre part ?
Il n’est pas faux que depuis douze ans que je publie, j’ai pas mal varié les formes. Il me semble qu’un contenu donné appelle sa forme. Et peut-être aussi son style. Même si je pense qu’en y regardant bien on finirait par dégager un schéma type de ma phrase. À un certain moment, un style se forme, se fixe, comme chez les peintres –Picasso, à partir de 1915, a trouvé sa patte. Et Claude Simon à partir de La route des Flandres. Etc.
Ce qui n’est pas arrêté dans mes livres, c’est le registre. C’est peut-être ça dont vous parlez. J’aime alterner de dialogues très oralisés, et des segments de narration très écrits. J’aime nouer le très trivial et le très raffiné. Parce que la vie ne cesse de les nouer, et que j’ai une égale passion pour l’un et l’autre.
Dans presque tous vos livres, il y a une remise en cause des normes sociales. Un questionnement au moins. C’est un poids pour vous ?
Je ne sais pas si la « remise en cause » est si claire que ça, mais il est vrai que dans La Politesse, Entre les murs, Le moindre mal, je décris des structures dysfonctionnantes, et le socle absurde de l’organisation actuelle de la société. Ce qui me semble, quand même, être le point n°1 de toute pensée critique. Mais aussi le point nodal de tout le foucaldisme : il n’y a pas de bonne société, la société en soi est une structure aliénante. C’est pourquoi il n’y a rien de plus éloigné de moi que ce vœu de « faire société » qu’on entend maintenant dans la bouche de tout le monde. L’horizon de mes ruminations politiques reste l’autonomie par rapport au maillage social. C’est ce que décline la troisième partie de La Politesse.
Une écriture qui ne suit pas les règles. Une narration qui les remet en question. L’anarchie est un terme qui a été dévoyé. Pour vous, qu’est-ce que l’anarchie ?
D’une certaine manière la réponse précédente commence le boulot. J’ajoute que le cœur de l’affaire, c’est cette histoire d’autonomie, qui se décline en initiatives autogestionnaires mais pas seulement. Anarchiste, c’est un tempérament. Je suis anarchiste en tant que je ne connais pas de plus beau spectacle que la reprise en main, par un individu ou par une collectivité, de son destin, de sa vie, de son corps. Je suis anarchiste en tant que je postule que nul n’est fondé à parler, agir, savoir à ma place. Mon anarchisme est un individualisme. Mais il se peut très bien qu’un individu choisisse librement de penser que son émancipation personnelle passe par son ralliement à des énergies collectives. Ce qui est un peu mon cas. Il faut encore et toujours dissiper ce malentendu qui a fait tant de tort à la gauche : le collectif n’est pas une finalité mais un moyen. Un des moyens que l’individu a à sa disposition pour s’émanciper. La finalité ultime de l’anarchisme, c’est l’actualisation des puissances individuelles, collectivement ou non.
Vous avez un passage dans La Politesse, page 136, qui explique pourquoi la culture sera toujours le fait de la bourgeoisie. Deux questions. D’abord, vous y parlez d’une inégalité fondamentale des chances, celle de la naissance dont on maintient l’illusion de l’abolition depuis la fin de la monarchie. Est-ce que concrètement, quelque chose peut-être fait contre cette inégalité ? Seconde question, j’ai l’impression qu’à part Zizek, vous êtes le dernier écrivain à employer le terme « bourgeoisie ». Qu’est-ce que vous mettez derrière ce terme ?
D’abord je tiens à vous féliciter d’avoir remarqué ce passage, que la critique à allègrement zappé, ainsi que toutes les mentions de ce mot. Et pour cause : la bourgeoisie a toujours intérêt à nier les appartenances de classes. Et le petit monde culturel préfère ne pas trop penser à sa large composante bourgeoise ; préfère se repaitre de grandes phrases sur l’universalité de la culture, et la cause des livres, et nanana.
Un petit point : je ne parle pas d’inégalité des chances. Cette expression est une invention des dominants pour légitimer les inégalités tout court. On donne à chacun les mêmes « chances », mais ensuite il est normal que des gens possèdent deux résidences secondaires alors que d’autres n’ont pas de logement. À l’ESSEC, école de commerce, ils ont un programme « égalité des chances », c’est tout dire. Je ne suis pas pour l’égalité des chances mais pour l’égalité. Je suis pour que l’ouvrier du bâtiment gagne autant que le chirurgien, indépendamment des études et autres. Puisque l’école ne rectifiera jamais les inégalités, puisqu’elle a vocation à les perpétuer, un moyen beaucoup plus rapide d’instituer l’égalité, comme rappelé par le clochard céleste de La Politesse, est d’assurer ici et maintenant l’égale distribution des biens.
Il est vrai que je me sens parfois un peu seul, dans le champ littéraire en tout cas, très marqué à droite (dans celui des idées, c’est moins vrai), à parler de classes sociales. Je suis indécrottablement marxiste en cela : il y a des classes, et l’appartenance à elle détermine beaucoup de pensées et de comportements. La société est structurée par des rapports de classes. Et l’État, dans cette société là, n’est que le fondé de pouvoir de la classe dominante.
Je pourrais certes me contenter de cette notion très opératoire : la classe dominante. Mais bourgeois a quelque chose de plus concret, de plus physique, de plus personnel. Bourgeoisie serait peut être le terme littéraire, et digne d’usage dans un roman, pour désigner l’ensemble des personnes qui composent la classe dominante.
Reste à savoir ce qui fait de vous un bourgeois, et si ça vous caractérise vraiment. Pour avoir beaucoup observé cette espèce dans le lycée de Nantes où j’étais, puis dans le champ culturel qu’elle squatte, je sais que cet identifiant est pertinent. J’écrirai un jour plus longuement là-dessus.
Vous évoquez aussi dans ce livre, le désir d’être lu pour un écrivain. Rarement les écrivains l’évoquent. D’ailleurs, c’est étrange comme désir. Dans la plupart des autres arts, on s’exprime face au public. En écrivant, on accepte d’être écouter sans avoir son mot à dire.
Soyons mathématiques : un film qui ne marche pas fait 100.000 spectateurs, ou 300.000 si le budget de départ ambitionnait le million. Ca fait quand même du monde, et ceux qui l’ont fait auront quand même une bonne chance de croiser ici et là des gens qui l’ont vu.
En littérature, un roman qui se vend à 5.000 c’est considéré comme vraiment pas mal, 10.000 une réussite, et plus de 10.000 un jackpot. 99% des livres publiés se vendent en moyenne à 200-300. Résultat, un écrivain est un type ou une nana qui fatalement, ne cesse de rencontrer des gens qui ne l’ont pas lu. C’est moins le désir d’être lu que j’évoque dans La Politesse, que cet état de fait. État de fait dont l’auteur peut très bien s’accommoder, dont il ne devrait même pas s’attrister, puisque la littérature a toujours été très minoritaire dans les pratiques humaines. Moi ça ne me pose pas de problème d’être lu par 10.000 et parfois moins. Ce qui est un peu plus irritant, c’est les gens qui prétendent avoir un avis sur vous alors qu’ils n’ont pas lu une ligne. Dans mon cas, ils sont nombreux. Je me demande même si je suis pas le recordman mondial du nombre de gens qui ont un avis sur un mec sans du tout connaître son travail. J’en suis assez fier.
Vous décrivez la promotion comme un monde presque irréel, absurde. Pendant vos semaines, vos mois de promo, est-ce que parfois vous avez l’impression de décrocher de la réalité ?
Une amie m’a dit que les deux premières parties du livre, censément réalistes, étaient de nature fantastique, et que c’est la troisième, censément utopique, qui était la plus réaliste. On ne peut pas dire mieux. Le champ culturel, et par extension le champ social, me paraissent des réalités bien étranges, bien incongrues, des machines absurdes dont les citoyens seraient les rouages consentants et masochistes Nous nous sommes faits du mal, écris-je. Nous nous sommes mis dedans. Nous avons tissé une toile, la société, dans laquelle nous sommes pris. Essayons donc, comme les évadés de prison, comme Edward Snowden, de passer entre les mailles.
Pour vous, c’est quoi la politesse ?
La politesse est d’abord un ensemble de conventions qu’on assimile et qu’on exécute. Merci, bonjour, pardon. J’aime assez ça, je l’ai apprise et je la pratique sans rechigner (avec même un certain plaisir, il y a un plaisir de la politesse). Mais hors de ces balises conventionnelles qu’on récite sans trop y penser, la politesse est bien plus que ça : une faculté de l’intelligence. Hors les conventions, c’est-à-dire dans son registre plus improvisé, elle est une capacité intuitive qui permet d’évaluer si je gêne les autres, si je les embarrasse. Ca va du bruit que je fais aux phrases que je prononce, et dont j’ai l’intuition ou non qu’elles peuvent être perçues comme indélicates par tel ou telle.
Ca m’est arrivé hier : dans un carré de TGV, le type en face de moi est au téléphone et parle d’une voix largement audible. Moi j’ai dans l’idée de lire un roman et ça me dérange un peu cette voix. Bon, je me dis que ça va pas durer, mais en fait ça dure. Donc j’attends : le type aura-t-il de lui-même l’intelligence intuitive que sa voix perturbe ma lecture ? J’attends encore. Mais rien à faire, le mec continue. Alors je finis pas lui dire, au bout d’une demi-heure. Et il dit : fallait me le dire. Et moi: non, j’ai pas envie d’être un flic, j’espérais que vous compreniez par vous-même. Et lui : comment je peux savoir que ça vous dérange ? Et moi : ben par déduction simple, et par précaution, par égard a priori ; peut-être qu’en fait cette voix ne me gène pas pour lire mais sait-on jamais. Lui : fallait me le dire. Moi : pffffff. Irritation, énervement, postillons etc.
Cette situation montre bien que l’autogestion, la prise en charge de leur vie par les gens eux-mêmes, a besoin impérativement d’un socle de politesse. Si nous ne déléguons plus à des flics ou autres la tache de maintenir la concorde, alors c’est à nous de le faire, et ça demande une intuition très fine du corps des autres, une empathie avec ce qu’ils ressentent. J’ai dit que l’anarchisme se souciait de l’individu. En l’occurrence ont voit que l’anarchisme est un altruisme. Il est la version physique et intuitive de l’altruisme. On en fait des caisses, toujours, sur l’Autre, la rencontre avec l’Autre, etc. Cette poésie républicaine m’indiffère. Pour moi l’autre, sans majuscule, c’est un corps, un corps avec lequel je dois composer, avec lequel je dois composer ma vie comme on compose une salade ou un morceau de rock.
J’ai éprouvé tout ça d’abord dans le milieu punk, des années 90, faits de lieux autogérés, de structures minoritaires et souvent auto-suffisantes. Une grande politesse y régnait. Une grande intelligence de ce qu’il est bon que chacun dise ou fasse, ou ne dise et ne fasse pas, pour que la structure tienne. Je l’éprouve aussi dans le groupe d’amis qui tournait autour des Zabs, puis qui a créé le collectif Othon : grande politesse aussi. Un groupe d’amis c’est une unité autogérée. Une niche qui invente en permanence ses lois, ses principes de fonctionnement, et qui les invente, spontanément et sans chef. Comme dit Nina dans la troisième partie : l’amitié est un modèle politique.
Il y a un aphorisme génial dans votre livre, qui passe presque inaperçu au milieu d’un monologue. « La subversion, c’est la complexité. » Notre époque souffre de la simplification ?
Je le dois à des types de Radio Nova qui font une émission qui s’appelle le pudding. C’est leur slogan. Ma troisième partie est tissée de mots, formules, hypothèses de vie récoltés ici et là dans les intervalles du majoritaire. À ce titre elle fait ce qu’elle dit : elle est une création collective. Elle fait exploser la notion d’auteur. Même si c’est moi qui reste à la baguette, car je tiens à signer de mon nom pour avoir le Goncourt
Un mot sur votre premier livre, Jouer juste. J’aimerai savoir comment on pense à commencer par ça pour écrire, parce que c’est casse-gueule et en plus, ça a assez peu de chance d’être publié ?
Vraiment à l’époque je ne me posais pas cette question. Je l’ai écrit comme ça, et qui m’aime me suive. À tout prendre, je m’imaginais plutôt que sa bizarrerie formelle jouerait en sa faveur, car à l’époque j’étais convaincu que beaucoup d’éditeurs pensaient comme moi qu’un livre vaut d’abord pour sa proposition formelle. Ça c’était une grosse erreur d’appréciation… D’année en année j’ai pu mesurer à quel point les torsions formelles sont peu prisées, peu commentées, et que toute sortie hors des structures canoniques (récit, langue usuelle, identification, sujet fort) vous condamnaient immanquablement à l’insuccès. Mon livre le plus audacieux formellement, Fin de l’histoire, est celui qui s’est le moins vendu. Il ne sortira même pas en Poche. Voué au néant, comme tout le pan expérimental de la littérature. La blessure la vraie s’est bien vendu, mais si jamais j’avais écrit le début du livre sur le registre étrange de ses cent dernières pages, et non sur le mode réaliste-identificatoire (l’été les vacances l’adolescence), il aurait fait un bide.
J’aimerais aussi savoir comment on écrit un tel texte ? Il donne vraiment l’impression d’avoir été écrit d’une traite, ce qui veut dire qu’il est réussi, mais pas que ce soit forcément le cas.
D’une traite, n’exagérons rien, mais c’est vrai que la première mouture est sortie en à peine une semaine. Il faut dire qu’à l’époque j’avais un nègre performant. Disparu depuis dans un avion de Malaysia Airlines.
Une dernière question : ça ne vous emmerde par vous, quand tout le monde parle de Pedros, Ouédec et Loko, alors que c’est Japhet N’Doram qui faisait tout le boulot ?
Pour avoir souvent vu jouer Japhet, je peux témoigner que c’était un peu tout ou rien. Certains soirs, il était le meilleur joueur du monde. Et d’autres fois il était à peu près de mon niveau, en pire. Si c’est possible.
Kiss

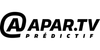
![[SIGNED] 99% YOUTH](/content/images/size/w100/2025/05/45668793_257109521655448_5873169637553733632_n.jpg)






![[INTERVIEW] Luiza Rozova, fille de Poutine : "Pour moi, les plans de vengeance relèvent du suicide karmique"](/content/images/size/w100/2025/06/IMG_8972--2-.webp)


